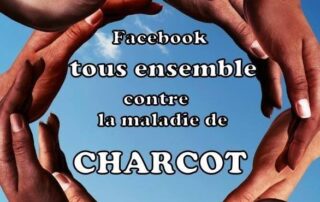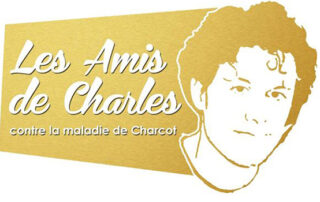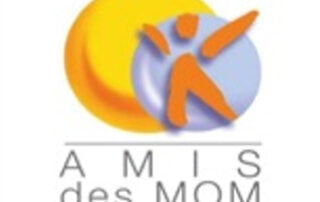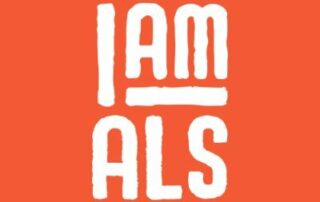LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE OU SLA
Pour rappel , la SLA c’est
Voilà ce que dit la Fédération Française de Neurologie
La SLA est une maladie neurologique qui atteint sélectivement les cellules nerveuses qui assurent notre motricité volontaire, c’est-à-dire la contraction de nos muscles sous l’influence de notre volonté. Ces cellules nerveuses motrices sont de deux types :
- les neurones moteurs centraux, situés dans une région particulière de notre cerveau, le cortex moteur, qui sont activés sur notre commande et vont transmettre cet ordre jusqu’à la moelle épinière.
- les neurones moteurs périphériques, ou motoneurones, qui sont situés dans une région de la moelle épinière, la corne antérieure, et qui vont transmettre la commande motrice jusqu’aux muscles, par l’intermédiaire des nerfs.
Elle est aussi appelée maladie de Charcot, du nom du neurologue français qui l’a décrite à la fin du 19e siècle.
Le terme « sclérose » vient du tissu cicatriciel, scléreux, qui remplace les neurones moteurs atteints par la maladie, « latérale » car les prolongements de ces neurones occupent la partie latérale de la moelle épinière, « amyotrophique » car les muscles qui ne sont plus commandés par les motoneurones vont s’atrophier. Elle touche surtout l’adulte entre 40 et 70 ans, un peu plus souvent les hommes que les femmes. En France, il y a environ 1 000 nouveaux cas de SLA par an, et environ 6000 personnes en sont atteintes. Elle s’observe dans toutes les régions du monde.
Pourquoi la SLA ?
D’après la Fédération Française de Neurologie, la cause première de la SLA n’est pas connue. Elle est classée dans les maladies dégénératives du système nerveux, comme la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer, mais les cellules nerveuses atteintes sont différentes (sélectivité pour les cellules nerveuses motrices dans le cas de la SLA). Ces neurones vont mourir progressivement. Cette maladie n’est pas contagieuse et aucun agent infectieux, viral en particulier, n’a été trouvé. Il ne s’agit pas d’une maladie transmissible à sa descendance dans l’immense majorité des cas. Dans 10 à 20% des cas, on peut observer plusieurs cas dans la même famille, on parle alors de SLA « familiale ». Ceci ne signifie pas que la cause est uniquement génétique, mais qu’il peut y avoir dans cette famille un terrain favorisant la survenue de la maladie (gènes de susceptibilité). Si l’on ne connait pas la cause première de la maladie, certaines étapes précédant la mort des neurones moteurs sont connues et font l’objet de beaucoup de travaux de recherche. Leur but est de mieux comprendre et de mieux traiter ces mécanismes (rôle d’un excès de glutamate, d’anomalies d’une oxydation particulière ou stress oxydatif).
Le mécanisme de la SLA
LA MALADIE EST GÉNÉRALEMENT SPORADIQUE, MAIS IL EXISTE DES FORMES GÉNÉTIQUES FAMILIALES
Dans la grande majorité des cas, la maladie est sporadique, c’est-à-dire qu’elle survient isolément en l’absence d’autres cas de SLA dans la famille. Dans ces cas, elle n’est pas transmissible.
Les formes familiales, définies par l’identification d’au moins 2 cas dans une généalogie, représentent 10 à 15% des cas de SLA. Ces formes sont liées à des mutations génétiques. Il faut toutefois savoir que, étant donné le caractère non exceptionnel de la SLA, la survenue de deux cas dans une même famille peut être liée au hasard et n’implique donc pas nécessairement le caractère génétique de la maladie.
Le statut de SLA familiale ne peut être défini pour un individu donné que s’il existe un autre cas de SLA dans la famille, quel que soit le degré de parenté, et si une mutation génétique a déjà été identifiée dans cette même famille. Attention, le mode de transmission varie selon le gène en cause, d’où l’importance du conseil génétique.
La recherche de mutation dans un gène causal se fait par analyse de biologie moléculaire sur une prise de sang, dans le respect du contexte réglementaire.
Seule la détection d’une mutation génétique reconnue causale permet d’affirmer le caractère génétique de la maladie.
En l’absence de détection d’une mutation, on parle de SLA sporadique, sauf si le contexte familial objective d’autres cas. On parlera alors de SLA génétique sans gêne objectivé.
L’ORIGINE PRIMAIRE DE LA SLA SPORADIQUE RESTE INCONNUE
On ne connaît pas la cause initiale des formes sporadiques de SLA. La maladie est probablement multifactorielle, faisant intervenir des facteurs environnementaux et probablement également des facteurs de susceptibilité génétique. Certains facteurs environnementaux ont été suspectés, mais aucun n’a pu être confirmé à ce jour. Le rôle favorisant d’une activité physique importante ou de traumatismes répétés a été soulevé, mais n’est pas prouvé. Quelles que soient les hypothèses formulées à partir d’études réalisées sur de larges populations de patients, il faut souligner qu’aucune donnée actuelle ne permet de remonter à une cause environnementale dans un cas individuel.
On connait par contre la cause des formes génétiques de la maladie : mutation reconnue causale dans les gènes identifiés. Elles représentent un groupe hétérogène. Certaines sont liées au dysfonctionnement d’un gène unique (« formes monogéniques »). C’est dans ces formes que les progrès de la génétique ont permis d’identifier certains gènes responsables. L’anomalie la plus fréquente est une mutation dans le gène C9ORF72 (près de 50% des formes familiales) ou dans le gène de la SOD1 (responsable que d’environ 15% de l’ensemble des formes génétiques). Une quarantaine de gènes de causalité sont identifiés, tels TDP43, FUS, ou TBK1…, certains n’affectant qu’une population très limitée. D’autres formes correspondent à une hérédité complexe, le développement de la maladie nécessitant probablement la présence d’anomalies de plusieurs gènes (« formes multigéniques »).
Cette forte hétérogénéité explique que devant une forme familiale de SLA, il n’est pas possible d’identifier une anomalie génétique dans tous les cas.
LES MÉCANISMES BIOLOGIQUES DE LA SLA SONT DE MIEUX EN MIEUX COMPRIS
Augmentation de l’excitabilité des neurones moteurs. C’est sur cette base qu’est utilisé le Riluzole.
La maladie résulte d’une cascade d’événements biologiques multiples conduisant à la mort des motoneurones. Beaucoup de progrès ont été réalisés dans la caractérisation des anomalies, notamment grâce à l’analyse de modèles animaux de la maladie et de la connaissance des anomalies génétiques.
Anomalies des mitochondries*, organites* cellulaires qui produisent l’énergie nécessaire au métabolisme des motoneurones. Leur rôle est important, mais vraisemblablement induit. Leur souffrance conditionne le motoneurone à entrer dans une voie finale de mort cellulaire où
interviennent des phénomènes d’apoptose (ou « mort cellulaire programmée»).
Accumulation reconnue de protéines mal formées (type TDP43, FUS ou SOD1) dans les neurones moteurs. Par analogie à ce qu’on connaît des maladies à prions, cette accumulation serait à l’origine de la dégénérescence et leur transmission de cellule à cellule pourrait expliquer la diffusion progressive de la maladie. Ces mécanismes sont particulièrement reconnus dans les formes génétiques, mais existent aussi dans les formes sporadiques.
Certaines anomalies génétiques identifiées dans la SLA codent pour des protéines qui ont un rôle direct dans l’immunité et la neuroinflammation. Ainsi, l’expression de cellules de l’immunité de type CD4 et CD8 est modifiée, tout comme les mastocytes qui participent aux réactions immunitaires.
- Les mécanismes de dégénérescence du neurone moteur sont interdépendants et ont probablement une importance relative qui varie en fonction des stades de la maladie.
- Il est de plus reconnu qu’il y a différentes SLA. Toutes sont l’expression symptomatique de la mort des neurones moteurs, avec une extension « en tache d’huile ». Mais chaque SLA d’origine génétique représente selon le gène en cause une maladie à part entière avec ses propres mécanismes moléculaires. Les SLA sporadiques d’un autre coté résulteraient de causes initiales différentes (immunitaires, métaboliques, transport et excitabilité axonale…) associées à des facteurs de susceptibilité. Ce qui parait très vraisemblable puisqu’on sait que l’expression clinique des SLA est variable tant dans la topographie des régions atteintes, que dans leur gravité ou leur vitesse d’évolution.
Nous faisons donc appel à vous, chercheurs, médecins, scientifiques pour explorer la piste de la TMF.